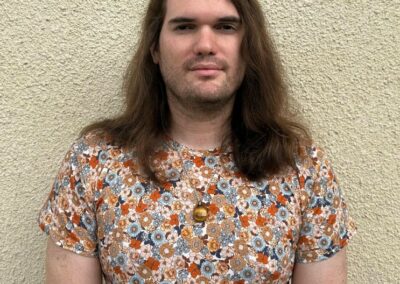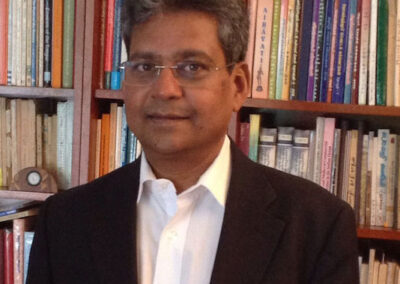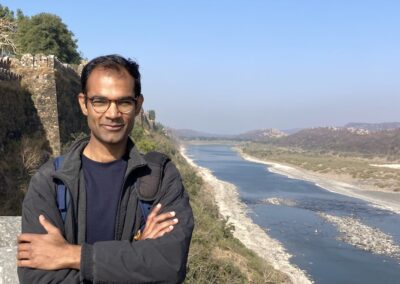Doctorante/ATER USN 2025-26
ED 625 Mondes Anglophones, Germanophones, Indiens, Iraniens et Etudes Européennes – MAGIIE
Biographie
Depuis 2020, doctorante à l’Université Sorbonne Nouvelle, sous la direction d’Isabelle Ratié. Elle se spécialise dans l’étude du Pātañjalayogaśāstra, traité de yoga classique du IVe-Ve s. Son sujet de thèse porte sur la figure du « Seigneur » (Īśvara) dans ledit traité ainsi que dans ses commentaires majeurs. En plus du sanskrit, elle a étudié également les prakrits jaïns (2018) et le pali (2020). Ses axes de recherches englobent le yoga/sāṃkhya, le jaïnisme et le bouddhisme indien dans leurs dimensions religieuse, philosophique et pratique. Avant d’entreprendre un cursus en études indiennes, elle a obtenu un Deug de Lettres Modernes en 2003 à Montpellier et a travaillé pendant près de vingt ans dans le domaine de l’hôtellerie/restauration.
Domaines de recherche et projets en cours
Dans la littérature philosophico-religieuse indienne, la figure du « Seigneur » (« Īśvara » en sanskrit) ne fait pas l’unanimité parmi les systèmes indiens. Le « Seigneur », lorsque son existence est reconnue, est considéré comme omniscient et omnipotent. Souvent aussi, il est un créateur et est assimilé à la divinité suprême. De nombreux et illustres philosophes indiens se sont intéressés à sa nature et à sa fonction. Le Pātañjalayogaśāstra regroupe 195 aphorismes et leur commentaire le plus ancien. Dans ce système, le « Seigneur » est une entité singulière : rapprochée du principe conscient inactif, son rôle reste très limité et n’est jamais créateur. Cet « Īśvara », qui n’est pas cause de tout, a considérablement gêné les commentateurs ultérieurs. Certains se sont donc fait un devoir de redéfinir sa place et sa fonction. Si des travaux ont été menés, aucun n’est exhaustif. Nous nous proposons d’étudier la définition, la construction et la déconstruction de cette figure du « Seigneur » dans un corpus considérable, comprenant le Pātañjalayogaśāstra accompagné de ses commentaires majeurs (Ve-XVIe siècles). Nous étudierons également des passages de textes appartenant à des systèmes connexes, théistes ou non. En outre, nous nous intéressons également au chapitre deux du Tattvasaṅgraha (et sa Pañjikā), des bouddhistes Śāntaraksita et Kamalaśīla (tous deux du 8e s.). « La critique du Seigneur » s’oppose furieusement aux théories du nyāya et du vaiśeṣika, mouvements en faveur d’un Seigneur organisateur des mondes. En plus de présenter une traduction annotée, nous établissons une édition critique à partir du manuscrit de Jaisalmer et des éditions de Krishnamacarya (1926) et de Śastri (1981, 1re éd. 1968).
Profils HAL et Academia
Autres pages web
Articles dans une revue
- Fabienne Bagnis. James Mallinson et Péter-Dániel Szántó, The Amṛtasiddhi and Amṛtasiddhimūla : the Earliest Texts of the Haṭhayoga Tradition. Bulletin d'Études Indiennes, 2022, 35, pp.261-264. ⟨hal-03951102⟩
- Fabienne Bagnis. Kengo Harimoto, God, Reason and Yoga : a critical edition and translation of the commentary ascribed to Śaṅkara on Pātañjalayogaśāstra 1.23-28. Bulletin d'Études Indiennes, 2022, 35, pp.257-261. ⟨hal-03951076⟩